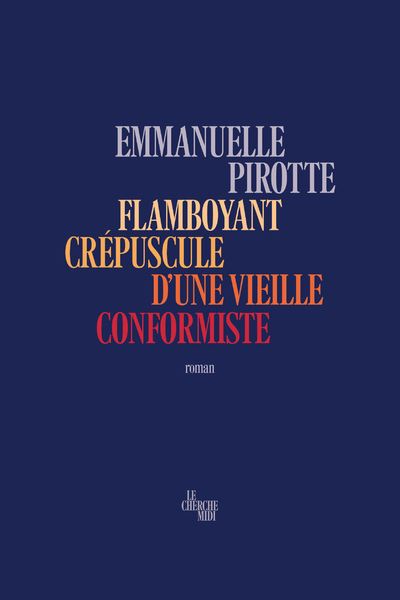

Emmanuelle Pirotte est historienne et scénariste. Elle publie son premier roman, Today we live, en 2015. Ce sera un succès qui remportera le Prix Historia, le prix Edmée de La Rochefoucauld et celui des Lycéens en Belgique. Suivront De Profundis (2016), une dystopie avant-Covid, Loup et les hommes (2018) – mon livre préféré des mois durant, puis D’innombrables soleils (2019), tous aux éditions du cherche midi. Rompre les digues, son cinquième, est publié, lui, chez Philippe Rey. Les Reines, sorti en 2022 au cherche midi, énorme en pagination et probablement le plus “fort”, est le seul à ne pas figurer dans Bouquivore en raison d’une année particulièrement difficile pour la SL. Un de leurs charmes : tous, sans exception, sont d’inspiration et de genre littéraire différents.
Sur une courte durée, l’histoire, racontée en direct de la première à la dernière page et à la première personne par la narratrice, Dominique Biron, est le récit des trois derniers jours de sa vie. Ayant appris quelques mois plus tôt qu’Alzheimer l’avait rattrapée à quatre-vingt-un ans, Dominique, plutôt bien conservée physiquement, alerte et “presque” sans douleurs, et toujours intellectuellement non limitée, décide qu’elle mettra fin à ses jours dès qu’elle verra la maladie évoluer dans le mauvais sens. De se suicider pour dire les choses clairement.
La théorie est simplissime : concrètement, elle commencera ses préparatifs un lundi et devra arriver à “ses fins” le mercredi suivant. Le lundi (matin) est en général le jour des grandes décisions. Lundi j’arrête de fumer, lundi retour à la salle de sport, lundi je diminue les écrans, lundi je me mets au régime, lundi je commence ceci et j’arrête cela… le lundi matin tout est promis, le mardi tout est oublié. Sans l’épée d’Alzheimer au-dessus de la tête, il est facile de remettre au lendemain, au lundi suivant.
Malgré les déclarations lénifiantes de son médecin, pour Dominique Alzheimer est là et bien là, il se fait même de plus en plus pressant. La maladie s’installe rapidement et seulement six mois plus tard, elle sent que le moment du sprint final est arrivé. Elle décide courageusement un lundi tôt le matin de se libérer de la vie le surlendemain à 20 heures. Trois jours pour mener à bien et proprement ce dernier projet d’une importance capitale. Trois jours et seulement deux nuits pour liquider ses affaires et quitter la vie pour la mort. Elle n’a pas encore choisi la méthode, elle voudrait juste, comme on la comprend, ne pas trop souffrir.
Le plus difficile : Victoire, vingt ans, sa petite fille, libre et lumineuse. La seule qu’elle aime d’amour et qui l’aime tout pareil et tout autant malgré ou grâce au mauvais caractère qu’elles partagent. La seule qu’elle aura du mal à laisser. Elle doit trouver un moyen de lui dire adieu sans la mettre sur la voie. Par chance, Victoire vient justement déjeuner ce lundi. Dominique essaiera d’en profiter au maximum sans rien laisser paraître : aucun indice ; ne rien changer à ses petites habitudes, mieux, aller se faire vacciner avec sa fille Catherine, comme c’est prévu. Et préparer pour le repas de Victoire ce qu’elle aime.
Durant ses préparatifs, Dominique convoque malgré elle des personnes de sa famille et de son entourage sous forme de souvenirs qui l’assaillent, lointains et désordonnés ; des tranches de vie qui nous permettent de mieux la connaître et la comprendre. De mieux l’estimer. Ce ne sont pas les surprises qui manquent, le sort lui ayant réservé des moments de grâce pure et d’autres d’une tristesse infinie. Et un ennui quasiment perpétuel. Le passé éclaire toujours le présent, entend-on, même s’il faut plutôt regarder devant soi, vers le futur. Plus facile à conseiller qu’à faire, le passé nous tirant par la manche pour nous seriner que tout revient à lui. Ici, il n’existe plus que sous forme d’éclats, la durée du présent à vivre est si courte et l’avenir non envisagé que je ne peux vous en dire beaucoup plus.
Le suspense est là, il se resserre dans les dernières pages, jusqu’à une fin qui est loin d’être attendue quand bien même les issues ne sont pas très nombreuses…
Pour ce qui concerne la forme, Emmanuelle Pirotte, experte en mutations stylistiques, se glisse avec aisance dans la bouche, dans le “je” narratif de son personnage. C’est Dominique qui parle et s’emporte avec panache, dans une langue populaire toujours directe, avec une gouaille chargée d’humour noir et un fatalisme désopilant. Sans oublier les envolées d’une grande qualité stylistique quand elle évoque les arts. Une double personnalité, un double langage. Cette alternance nous met le sourire ou le rire aux lèvres en dépit du sujet, même si parfois on peut trouver que la belle en fait trop.
Côté construction, la pagination raisonnable autorise une forme simplissime : chaque jour fait l’objet d’une partie, sans chapitres intérieurs. Trois jours, trois parties : “Lundi”, “Mardi” et “Mercredi”, de longueur à peu près égale. À l'intérieur des parties la chronologie est bousculée par les souvenirs désordonnés de Dominique, mais le présent du jour concerné confère une grande homogénéité à l'ensemble.
Quant au titre de l’ouvrage, il est osé lui aussi : les deux premiers mots sont en contraste absolu avec les deux derniers. Et s’il surprend au début, il nous semble totalement adapté à l’intrigue, à sa protagoniste et sa progression dans son récit, elles aussi contradictoires.
Parmi les mots savoureux de la narratrice, j’ai bien aimé la définition imagée et très douce de son suicide planifié : “plier mon parapluie”.
Un regard sur le livre. Acheter un roman d’Emmanuelle Pirotte, c’est une promesse et une certitude. La promesse c’est d’être surpris, la certitude c’est de voir la promesse tenue de page en page. Car en ouvrant un de ses livres nous ne savons rien de l’espace-temps dans lequel nous allons nous trouver, même en ayant lu l’utile (ou exécrable c’est selon) IVème de couverture. Le lieu, la période, l’intrigue, la durée, les thèmes et le milieu changent radicalement d’un roman au suivant. Tout comme l’écriture. Chaque fois, le lecteur éprouve la sensation d'entrer dans un autre monde et se demande si c’est bien un Emmanuelle Pirotte qu’il tient entre les mains.
Il faut dire que cette autrice n’a peur de rien. Aucun sujet ne la rebute, tout la passionne et, probablement grâce à son statut d’historienne, ses romans sont documentés, investigués, référencés, vérifiés pour les faits historiques.
Elle est à l’aise dans tous les registres littéraires.
Personnellement je la lis depuis presque toujours, ayant commencé avec Loup et les hommes, son troisième roman, historique, puis De Profundis et Today we live, avant d’acheter les yeux fermés l’intégralité de ses romans et de les lire en cascade les yeux grands ouverts, avec un plaisir inchangé mais sans cesse renouvelé par la surprise.
Pourtant, même avec une bibliographie aussi variée, il fallait l’écrire, ce roman ! Il fallait oser l'écrire. Des “Tatie Danielle”, des “Vieilles dames indignes”, des personnages qui se suicident avec une bonne ou une mauvaise raison, il y en a plein les pages des livres. Des malades d’Alzheimer plein les familles et en nombre croissant, cette saleté nous étant présentée comme le pire du pire des maladies mentales connues liées à l’âge, des “vieux” et des “vieilles” en souffrance aussi, qui ne sont malheureusement plus avec leurs familles. Mais un suicide aussi motivé, organisé, préparé et découlant de ce monstre dans le cerveau, ça ne court pas les livres. Il faut du cran pour l’envisager, l’écrire et le publier.
Dans le roman, pas de myriade de personnages. Dominique Biron occupe à elle seule l'histoire et les pages. Autour d’elle, excepté Victoire, sa petite-fille adorée, gravitent quelques personnages secondaires fort peu sympathiques : ses enfants, ses gendres et quelques vagues connaissances.
A priori Dominique nous semble désagréable. Petite bourgeoise égoïste, radine, cynique voire sarcastique et méprisante, inculte, aigrie et râlant sur tout, elle a tout pour déplaire et paraître odieuse. Tous ces termes – et ceux que j’oublie – sont prononcés par celle-là même qu’ils décrivent, devenue, grâce à son espérance de vie de trois jours, totalement libre de faire son mea culpa en son âme et conscience, quitte à outrepasser les bornes de la bienséance. Son manque de culture qu’elle avoue avec des regrets proches de la culpabilité ne lui a pas permis de briller en société, alors elle attaque bille en tête, préférant mordre qu’être mordue.
Cependant, entre deux coups de gueule tonitruants, nous assistons à quelques scènes de son passé qui montrent une tout autre femme que l’impassible Dominique du présent, une femme matériellement à l’aise que la vie n’a pas épargnée. On la voit, par exemple, petite fille, pleurer face à la grande pauvreté de ses petits compagnons de vacances. Jeune, toujours, contrariée par un père autoritaire dans ses projets, mariée à un homme qu’elle n’aime pas, s’ennuyant ferme la plupart du temps. D’autres souvenirs la décrivent compatissante voire bienveillante, malgré son mauvais caractère toujours prééminent ; je vous laisse le plaisir de les découvrir, ils sont nombreux à avoir esquivé les sarclages d’Alzheimer.
Derrière le rideau des sarcasmes, les diatribes fallacieuses, les critiques acerbes et les boutades gratuites, se cache une tout autre réalité : l’humanité est bien au rendez-vous. Dominique Biron, si elle n’a pas été une grande altruiste, s’est surtout “aigrie” avec l’âge et la solitude ; ses enfants ne l’ont pas (ou mal) accompagnée, tous intéressés et jaloux de sa petite-fille Victoire. Fière, elle n’a jamais réclamé quelque attention de leur part et fini par accepter sans l’apprécier sa vie solitaire, consciente que ce sont uniquement son aisance matérielle et sa bonne condition physique qui lui ont épargné la maison de retraite.
Mais à mesure que se déroulent devant elle et devant nous des événements marquants de sa vie, le suspense est croissant et une émotion bienvenue commence à poindre dans nos poitrines. Après l’avoir détestée, nous nous prenons à l’aimer, étourdi(e)s même par des attendrissements inattendus.
Car au final, cette “vieille conformiste” n’est pas si vieille et si conformiste qu'il y paraît. Pas si étroite d’esprit, pas si saugrenue : il suffit de soulever un pan du rideau protecteur et elle nous ramène à n’importe laquelle d’entre nous. Dominique peut être l’incarnation de toute femme de plus de cinquante ans – Alzheimer peut commencer si tôt – seule, mal ou peu aimée de ses enfants et de sa famille, une femme parmi les autres femmes dont on ne parle pas. Qui n’a pas été malheureuse, mais pas davantage heureuse. Une femme qui rêvait d’un amour passionnel et rempli de sexe et a vécu avec un homme quelconque, mou et sans passion.
Selon les moments, elle peut être tout et son contraire, avec toutes les contradictions qui forgent une personnalité : pitoyable jusqu'au pathétisme, vacharde jusqu’au cynisme, courageuse et lâche. Franche et graveleuse, extrémiste parfois, changeante comme n’importe laquelle ou lequel d’entre nous – son prénom l’y autorise.
Pourtant, nous n’avons pas de quoi être fière ou fier face à elle. Tout d’abord, elle n’est jamais geignarde, pas même plaintive, même si son sort actuel et certains pans de son passé sont loin d’être enviables. Elle essaie toujours de compenser ce qu’elle sait être des défauts par une remise en cause de soi, tardive mais réelle.
Il n'est pas donné à tout le monde de reconnaître ses torts et ses faiblesses, moins encore de présenter des excuses.
Et si elle manque parfois d’indulgence, c’est vrai, mais elle n’en a pas davantage à son égard, se traitant de “vieille carne”.
C’est ce que j’ai trouvé le plus intéressant chez elle : la remise en question personnelle (et totale) après analyse de ce qu’elle s’entend dire et se voit faire à retardement “grâce” à la maladie. Vous me direz : Elle est censée mourir dans trois jours et deux nuits, alors c’est bien facile… Eh non, pas davantage que si elle devait vivre longtemps car elle aurait alors la considération des autres et la satisfaction de soi.
D’ailleurs ses sarcasmes, drôles et de mauvais goût, sont bien souvent dirigés contre elle, et contre des millions de personnes. A titre d’exemple, la scène au cours de laquelle elle se débarrasse de ses bibelots – et tout ce qu’elle en dit – est à mourir de rire et donnerait (donne ?) envie de tout virer de chez soi avant d’être contrainte de le faire. Je parle au féminin juste parce qu'il paraît que les hommes ne sont pas collectionneurs. Il paraît… De bibelots, c’est certain, pour le reste… Et le passage qui raconte ce que deviennent les bibelots est lui aussi hilarant. Je vous recommande les pages 26 et 27.
Flamboyant crépuscule d’une vieille conformiste est également un hommage rendu à l’art, à toutes ses formes dont la musique, la peinture et la littérature. Bien qu’elle manque de culture et le regrette profondément depuis qu’elle l’a réalisé grâce à sa fille et à sa petite-fille, Dominique n’est pas totalement ignare.
Dans cette sorte d’ultime confession, elle avoue connaître et avoir écouté maintes fois quelques morceaux de musique (classiques ou chanteurs contemporains dont Kurt Cobain) et sait en parler avec une emphase surprenante. Elle nous dit sur sa fille Dorothée :
“Je me sentirais moins seule, moins pauvre, moins vide si j'avais accepté de la suivre, de m'immerger dans la beauté, la vérité. Car elle disait toujours que ces deux concepts étaient très proches. Et je sens que c'est juste. Un grand roman, un tableau, un morceau de musique t'accompagnent parfois bien mieux que ne le ferait un être humain. Les œuvres d'art s'immiscent en toi et ne te quittent jamais, disait-elle, elles sont comme le pain et l'eau et l'air que tu respires, elles sont la nourriture qui te sauve. De tout, à commencer par toi-même”.
Si la musique lui procure toujours des sensations fortes, son plus grand regret est de n’avoir presque rien lu : elle a lu et relu UN livre : Les cendres d’Angela, Une enfance irlandaise de Frank McCourt (1930-2009), (“un des livres que Victoire m'a littéralement forcée à lire”. Elle en parle avec passion : “Elle a bien fait d'insister. J’ai peut-être compris avec ce texte pourquoi je me repais de médiocrité : vivre avec des personnages intenses, courageux, contrastés demande un effort, une forme d'engagement total de l'être. Cela nous confronte à notre propre insignifiante, à nos manquements”.
Merci Dominique, se faire conseiller un livre par un personnage de roman qui ne lit pas, et l’entendre dire que la lecture est aussi un engagement de soi… c’est peu banal, et plaisant.
Pour l’anecdote mais pas seulement, une autre qualité majuscule de Dominique : elle aime les chats et leur présence ; elle accueille bien volontiers celui qui pointe son museau et tente de le garder chez elle pendant ses trois derniers jours. Un chat, symbole de sagesse et de “zénitude” comme compagnon de dernier voyage, qui dit mieux dans les mêmes conditions ? Un gage de gentillesse ? Après tout, comme disait l’acteur-humoriste américain W.C. Fields : “Un homme qui déteste les chiens et qui aime le whisky ne peut pas être tout à fait mauvais”. Alors une femme qui aime les chats et le bon whisky…
Par ailleurs, Emmanuelle Pirotte est scénariste et ce dernier roman a une dimension théâtrale. Au théâtre il serait un excellent one woman show. Pour le fond, ce pourrait être une tragi-comédie par la légèreté (factice) avec laquelle la narratrice raconte ses “malheurs” et appréhende ce qui va suivre. Dominique est la plupart du temps seule et ne parle qu’à elle-même – en se tutoyant pour donner l’illusion d’être deux au même endroit. Hormis quand elle se cherche des interlocuteurs et interpelle les lecteurs en leur demandant un avis ou en leur proposant de boire un verre avec elle dans des passages émouvants. Un peu comme si elle tenait une conversation dont elle ferait à la fois les demandes et les réponses. Ou une confession sans curé (elle ne les porte plus dans son cœur depuis longtemps, guère plus que celui qu’ils représentent)...
Une autre marque de courage chez Dominique : la classe sociale qu’elle critique sans vergogne est la bourgeoisie, et elle ne s'en vante ni ne s'en cache. La grande bourgeoisie belge, celle qui se transmet de génération en génération, ou celle des parvenus (ou arrivistes selon les points de vue) partis de rien ou de peu et qui se sont enrichis, la sienne propre. Elle ne recule devant rien, citant des comportements injustes de sa famille ou de certaines connaissances, et le mépris jamais déclaré mais toujours ressenti pour “les vieux”, dont elle fait aussi partie.
Avant la mort, il y a la vieillesse et la fin de vie, souvent solitaires. Avec tout ce que nous entendons et lisons sur le problème de la vieillesse en France, je croyais que celle-ci avait l’apanage de leur maltraitance dans les Ehpad. Et j’étais toujours épatée dans quasiment toutes mes lectures nord-américaines noires, amérindiennes surtout de voir le respect de ces peuples pour leurs ancêtres, allant pour les Amérindiens jusqu’à les imaginer “matérialisés” quand ils viennent les visiter sous forme de fantômes.
L’amour transgénérationnel, la transmission de mère en fille, de grand-mère en petite-fille et même d’arrière-grand-mère en arrière-petite-fille), tout ça me fait chaud au cœur tout en m’interpellant : Et nous, et nous ? Louise Erdrich, Richard Wagamese, Joseph Boyden, Jocelyn Nicole Johnson récemment, dont les relations d’amour avec sa grand-mère sont à pleurer de beauté, toutes celles et ceux que j’oublie, et leur Père à tous le grand Jim Harrison…
Et, allez savoir pourquoi, je pensais que la Belgique, pays que j’ai idéalisé depuis que ma meilleure amie y vit, considérait encore ses vieux comme des “personnes âgées”, le terme “personne” n’ayant disparu que du vocabulaire français pour désigner les gens âgés. On entend encore parfois en province dire “nos anciens”, mais la plupart du temps il est socialement question des jeunes et des vieux, comme s’il n’y avait plus rien entre les deux et que les vieux n’étaient déjà plus des personnes avant même de mourir… “installés” dans des endroits conçus pour eux, sans mixité aucune, des mouroirs pendant les deux séquences du covid.
Dominique, du haut de ses quatre-vingt-deux printemps, tout en vitupérant sur la situation des vieux pendant le covid justement (dits “privilégiés” mais maltraités faute de moyens) fait parfaitement bien le distinguo entre les vieux riches voire très riches et les vieux pauvres voire très pauvres, ainsi que des différences de fin de vie qui en découlent. La population occidentale vieillit mais les gouvernements ne font pas grand-chose pour améliorer leurs conditions de vie et de santé. La vie est de plus longue, la santé ne suit pas. Vieillir, c’est la vie, mais à quel prix avant la mort ? Là encore, c’est une question de moyens – personnels, familiaux, et de santé publique. Les gens d’en haut ne considèrent pas la France d'en bas (ou le pays qu'ils gouvernent), les petites gens restent petits, les riches continuent de s’enrichir, et les misérables de manquer de tout.
Tout cela est exprimé en creux dans les propos déjantés et coléreux de Dominique. Elle défend les jeunes, les vieux, les animaux maltraités (chiens, chevaux surtout), les arts, les pauvres, la liberté, sa petite-fille… tout en les décriant parfois, excepté sa petite-fille et la liberté, symboles de tout ce qu’elle aurait souhaité être : libre et cultivée. Et bien entourée. Elle ne regrette pas de mourir mais d’avoir subi sa vie sans réagir plus tôt.
Le sujet majeur, la fin de vie choisie – Alzheimer n’en est qu’à l’origine – pourrait nous amener à croire que le système de la fin de vie et de l’euthanasie assistées belge – qui pour nous Français est un modèle envié qu'il faudrait imiter selon monsieur Macron –, n’est pas totalement au point. Je me suis trompée. Toujours est-il que nous avons tous été, sommes ou serons, concernés de près ou de loin et quel que soit notre âge par Alzheimer et la fin de vie en général. Inutile de se voiler la face, la vie ne se déroule que dans un seul sens : celui de la mort. Alors, autant en parler sans tabou et si possible choisir son heure et ses circonstances. Si l’aide à la fin de vie choisie (avec certaines conditions) était institutionnelle, de telles situations n’auraient pas lieu, la mort, et la vie qui la précède seraient plus simples… Pas seulement en Belgique ou en France.
Et qui mieux que les écrivains(e)s sont en mesure d'aborder de tels sujets avec mesure et efficacité, en nous incitant à réfléchir sur tous les thèmes sociétaux tabous et complexes à travers leurs “exemples” romanesques significatifs ? On apprend davantage de choses dans tous les domaines de la vie par les romanciers, les conteurs, les nouvellistes que par les essayistes (trop sûrs de leur fait, trop rigides), les scientifiques (trop compliqués) ou les théoriciens de l’histoire (souvent trop partiaux et conventionnels). C'est aussi un mérite de la littérature : nous ouvrir les yeux et nous inciter à en savoir davantage sur les questions qu’elle pose quand elles nous intéressent.
Emmanuelle Pirotte, romancière hors pair, le fait depuis toujours avec sérieux, compétence et humanité. Sans proposer de solution, ce n’est pas le rôle des écrivains, mais sans jamais porter de jugement hâtif. Qui lira verra.
Pour en venir au suicide, il y a deux “petites choses” qu’il ne faut pas écarter ni même oublier ou feindre de le faire. Que nous soyions ou non des assidus de la messe du dimanche, notre éducation judéo-chrétienne condamne le suicide. Or – et c’est là la première “petite chose” –, le suicide n’est pas l’envie de mourir, le souhait de la mort pour la mort. C’est l’envie de ne plus vivre, quelle qu’en soit la raison, ici c’est le diable Alzheimer qui invite la Faucheuse. Nous naissons dans la joie de nos parents, sortant du ventre de notre mère. Mais nous n’avons pas choisi de vivre. Dans la plupart des cas, nos parents ne sont plus là à l’âge où commencent pour nous les tiraillements de problèmes existentiels. Les bras et le cœur rassurants de notre mère pour nous aider, nous guider dans un choix difficile, pas plus que ceux de notre père… Quant à nos enfants, il serait malséant de les prévenir de notre désir d’en finir, et pour bien des raisons là encore. Question de religion ? Simple comme bonjour : Dieu nous a donné la vie, Dieu doit nous la reprendre. Et toc. Mais, par exemple, les enfants de la guerre, ont-ils choisi quelque chose ? Que vient faire un dieu dont l'existence n’a jamais été formellement prouvée dans la nôtre ?
La deuxième “petite chose” concerne le passage à l’acte. Le suicide est un choix difficile à assumer jusquau bout de la fin. Ce n’est pas un acte gratuit, facile et égoïste comme beaucoup le prétendent. Il ne laisse pas toujours une famille et des amis éplorés. Tant mieux ou tant pis. C’est exclusivement l’issue fatale d’un mal-être récent ou non, d’une absence irréversible à la vie quand tout n’est plus qu’échec et qu’aucun futur se profile. Quant au passage à l’acte, loin d’être une grande lâcheté, il demande au contraire un courage extrême, quelle que soit la méthode. C’est peut-être pour cette raison que Dominique s’est donné trois jours seulement pour “tenter” d'en finir et qu’elle avoue : “Cela m’aurait bien arrangée d’être emportée par le covid”… S’il était facile de se donner la mort (l'expression bien choisie signifie que la mort par suicide est un cadeau que se fait la personne), il y aurait moins de gens qui souffrent en l'attendant. N’est-il pas plus digne de choisir de “plier son parapluie” plutôt que de continuer à subir le fouet des averses que nous réserve la fin de notre vie ?
Tout bien considéré, Dominique m’a bluffée par sa double personnalité et son côté bravache qui n’a plus rien à perdre et vit en trois jours des événements certes courts mais bien plus excitants que l’ensemble de sa vie placée sous le signe de la médiocrité et de la solitude. Les relations avec ses enfants devenus adultes sont d’une justesse déplorable mais réelle dans certaines familles.
Je dirai pour finir qu'avec moins de deux cents pages, ce roman à l’intrigue sommaire mais très originale est d’une grande densité. Chaque phrase a son importance, chaque dialogue (ou monologue de Dominique), chaque mot sont sélectionnés avec soin, même quand la protagoniste semble dérailler. Un grand nombre de sujets sociétaux y sont abordés, parfois développés et Emmanuelle Pirotte, par l'intermédiaire de son porte-voix Dominique qui, parée du rideau de la maladie et de la vieillesse, n’y va pas par quatre chemins pour fustiger la bourgeoisie, les décideurs de très haut niveau, les ultra riches ainsi que des situations, des réflexions et des faits totalement absurdes.
Merci Emmanuelle Pirotte de nous faire réaliser qu’une origine (modestement) bourgeoise ne rime pas forcément avec élégance et beau parler, avec bienséance et bien pensance. Pas plus que l’aisance financière ne rime avec bonheur total même si la participation aux clubs de bridge, un sport cérébral prisé des plus aisés, est nettement plus coté que les tarots ou la belote. Merci de nous faire rire, aussi car y parvenir avec un sujet si sérieux et si grave tient de la gageure.
C’est aussi en cela qu’Emmanuelle Pirotte se démarque de la littérature frileuse qui fuit les sujets tabous. Elle ne choisit d’écrire que sur des thématiques casse-gueule et de ne mettre en scène que des personnages hors du commun. Inoubliables. Dominique Biron, avec son nom passe-partout, en est un.
Emmanuelle Pirotte ne tient pas compte des classes socio-culturelles et n’en épargne aucune (excepté les misérables, les petites gens, les sans-visage et sans biens). Elle excelle dans tous les genres, écrit comme pensent et parlent ses personnages. Son continuum c’est la diversité. Et des coups de cœur pour ses lecteurs.
Je vous recommande tous ses romans rien que pour cela : vous ne lirez jamais la suite de quelque autre, ils sont "autonomes". Vous avez bien de la chance si vous ne les avez pas lus…
Son chef-d’œuvre, peut-être : Les Reines, pour son actualité prophétique, sa construction en forme de tragédie antique et sa plume intense. Mais je changerai peut-être d’avis en postant cette chronique car il n’est pas si facile pour "commencer" avec cette autrice. Préférez De profundis ou Today we live…
Je n’ai toujours pas compris pourquoi elle est si peu nominée et donc couronnée par les (grands ?) prix littéraires. Y aurait-il des éditeurs plus enclins que d’autres à recevoir des prix ? Des grandes maisons d'édition par exemple ? Le monde de l’édition est-il soumis lui aussi aux compromis, aux compromissions, aux promesses entre deux couloirs, deux dîners, deux salons ?
Alors, à quoi ça sert de lire ? À pouvoir citer son poète préféré dans une chronique de sa romancière belge préférée. Plus sérieusement, à réfléchir sur la maladie d’Alzheimer qui effraie à peu près tout le monde, à ne pas juger une personne sur quelques paroles déplacées, à prendre du plaisir à lire une tragédie classique déguisée en comédie, ou l’inverse sans même s’en rendre compte. À réfléchir sur la vie, sur la vieillesse et la mort qui toutes peuvent être des solitudes, les larmes aux yeux ou en vous esclaffant…
Je n’ai pu m’empêcher en lisant et refermant ce livre de penser à la sublime chanson du poète Léo Ferré “Ne chantez pas la mort”, dont les paroles si belles et si justes sont de Jean-Roger Caussimon. J’aurais pu n’en citer que quelques strophes mais la décence m’a interdit de le faire. Je suis sûre que Dominique aurait aimé.
“Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide
Le mot seul jette un froid, aussitôt qu'il est dit
Les gens du "show-business" vous prédiront le "bide"
C'est un sujet tabou pour poète maudit
Je la chante et, dès lors, miracle des voyelles
Il semble que la mort est la sœur de l'amour
La mort qui nous attend, et l'amour qu'on appelle
Et si lui ne vient pas Elle viendra toujours
La mort, la mort, la mort
La mienne n'aura pas, comme dans le Larousse
Un squelette, un linceul, dans la main une faux
Mais, fille de vingt ans à chevelure rousse
En voile de mariée Elle aura ce qu'il faut
La mort, la mort, la mort
De grands yeux d'océan, une voix d'ingénue
Un sourire d'enfant sur des lèvres carmin
Douce, elle apaisera sur sa poitrine nue
Mes paupières brûlées Ma gueule en parchemin
La mort, la mort, la mort
"Requiem" de Mozart et non "Danse Macabre"
Pauvre valse musette au musée de Saint-Saëns
La mort, c'est la beauté, c'est l'éclair vif du sabre
C'est le doux penthotal De l'esprit et des sens
La mort, la mort, la mort
Et n'allez pas confondre et l'effet et la cause
La mort est délivrance, elle sait que le temps
Quotidiennement nous vole quelque chose
La poignée de cheveux Et l'ivoire des dents
La mort, la mort, la mort
Elle est l'euthanasie, la suprême infirmière
Elle survient, à temps, pour arrêter ce jeu
Près du soldat blessé dans la boue des rizières
Chez le vieillard glacé Dans la chambre sans feu
La mort, la mort, la mort
Le temps, c'est le tic-tac monstrueux de la montre
La mort, c'est l'infini dans son éternité
Mais qu'advient-il de ceux qui vont à sa rencontre?
Comme on gagne sa vie Nous faut-il mériter
La mort La mort La mort ?”
DES MOTS POUR BIEN LE DIRE
Vieillir sans mâcher ses mots, quitte à se contredire et faire un amalgame :
“Vieillir, ça se vit seul, en tout cas pas entouré d'autres vieux. Récemment, j'ai entendu une pub pour une maison de retraite, il y avait cette femme, une bobonne bien comme il faut, un peu mon style, et elle expliquait qu'elle avait voyagé avec feu son mari, la Chine, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, et viens que je t'en mets plein la vue, et que maintenant je continue à voyager, depuis mon petit salon qui pue le pet et la naphtaline. Enfin, c'est dans ses souvenirs qu'elle circule maintenant, mais elle a l'air de trouver ça formidaaable. J'ai eu des envies de meurtre. D’abord de la buter, elle et sa voix de bourge du Brabant wallon à la prononciation chuintante, elle et tout ce qu’elle incarne de médiocrité, ce qu’elle révèle de notre monde. Elle est ma soeur, mon double, sa voix ressemble à s’y méprendre à la mienne, et quand elle évoque sa vie, je m’entends raconter la mienne à des inconnus croisés dans une salle d’attente médicale ou chez des amis : oui, du temps où mon mari vivait encore, nous faisions une fois par an un grand voyage, croisière au Spitzberg, visite des parcs américains, le Japon, Sumatra… C'était toujours des voyages organisés pour les vieux cons, tour opérateur semi-luxe, chaînes hôtelières internationales, nourriture ad hoc, à quelques exceptions près”.
Sur la gestion du covid, la version critique mais vraie pour beaucoup de la vieille conformiste, qui se met honnêtement dans le lot “des vieux” :
“En réalité, tout le monde s'en tamponne des vieux. Enfin, certaines gens aimeraient garder un peu leurs propres d'antiquités. Mais de manière générale, notre société n'en a rien à foutre des vieux qui peuplent le monde, les anonymes, les sans visage, ceux des autres, ou pire : ceux qui ne sont plus à personne, les innombrables zombies qui traînent leur déambulateur dans les couloirs de l'oubli. Justifier de priver une population entière de liberté sous prétexte de préserver la vie des vieux est une des manipulations les plus cyniques de l'histoire. (...) Ils me rendent malade, moi, les gens de mon âge. Je ne vois que ça ici, dans ma rue bien comme il faut, dans mon quartier de retraités nantis mais pas vraiment riches. De petites gens qui n'ont pas trop mal fait fructifier leur argent, qui possèdent, comme moi, l'un ou l'autre appartement à la mer ou à l'étranger, ont une retraite plus que confortable, mais qui crèveraient plutôt que de laisser hériter leurs enfants avant de passer l'arme à gauche”.
Et quelques lignes plus loin, le plus juste, un peu trop généralisé peut-être :
“Je les vois, tous les Harpagon du Brabant wallon, les couples qui marchent bras dessus bras dessous, emmitouflés dans leur veste matelassée, ils arborent un air confit d'importance, de respectabilité, de bon droit qui me donne envie de vomir? Et c'est pire depuis le covid. Ils se sont de nouveau sentis importants, tout à coup, un nouvel âge d'or, l'heure de gloire ! Une maladie leur en voulait personnellement ! Et le monde se mobilisait pour eux, on se culpabilisait, on diabolisait les jeunes qui voulaient continuer à vivre, qui refusaient de se faire voler leur gaieté et leur jeunesse, leur belle soif d'exister. On a dit Mais c'est temporaire, enfin, ils peuvent bien faire ce petit sacrifice, les jeunes ! Mais un an de vie à vingt ans en vaut dix de celle d'un adulte pas trop débile, vingt de celle d'un con, bon sang, tout le monde sait ça quand même, même moi qui n'ai pas eu de jeunesse”.
Plus tard, elle harangue dans un train une vieille femme qui s’en prend à des jeunes un peu trop bruyants à son goût :
“Ça fait deux ans que les gens se privent de tout pour que toi et moi on n’aille pas entasser nos carcasses dans les hôpitaux, deux ans que ces jeunes-là n’ont plus de vie, plus d'air, plus d'espoir, plus de gaieté ! Déjà qu'on a fait crever la planète, qu'on a semé la terreur et la désolation, tu vas pas la ramener, non ?”
Merci Dominique de parler pour les jeunes, qui ont la vie devant eux. Celle que nous leur laissons, vous le dites si bien. Je suis d’accord avec vous, certains vieux devraient faire profil bas. Et pour les moins de vingt ans, être vieux ça commence bien avant cinquante ans”.
Les arts comme remède à Alzheimer :
Et si justement, c'étaient ces choses-là qui vous restaient, qui s'accrochaient à vous comme le chaton aux mamelles de sa mère, qui vous agrippaient pour ne plus jamais, jamais vous lâcher? Et si ce prélude était précisément ce qui résiste, ce qui creuse son sillon du fond du puits de votre mémoire défaillante, monte et jaillit de votre nuit pour vous inonder d'une émotion que l'on pensait perdue à jamais ? Et si cette émotion était à même de déterrer une trace, une bribe du passé, à lambeau de souvenir, un fil qui vous relierait à vous-même ? Peut-être est-ce cela qui advient. Peut-être”.
Sur la possibilité de choisir quand et comment mourir :
“Que nous reste-t-il aujourd'hui, en Occident, comme champs d'action d'expression de notre libre arbitre ? Enfin, de ce que nous prenons pour tel... Nous pourrions disserter longuement sur le libre arbitre, il n'existe pas, ou si peu, c'est mon avis, mais revenons à nos moutons : quid d'un monde où règne une pensée unique dominée par le compromis, la résignation, l'apathie ? (...) Eh bien je vais vous le dire : il reste la mort. Dans ce domaine, il y a encore une possibilité de poser un acte libre. On peut ne pas se contenter de l'attendre, on peut refuser la résignation, on peut ne pas devenir l'ombre de soi-même, on peut encore choisir !”.
En langage Dominique, une vision égoïste de l'après ? Je dirais peu rassurante…
“Me voilà prête pour ma dernière journée dans ce monde. Très honnêtement, je n'ai guère de regret de le quitter. Cet endroit de l'univers est devenu un cloaque. On nous annonce l'extinction de l'espèce humaine si nous continuons à vivre comme des porcs. Mais nous continuerons à vivre comme des porcs, et donc elle adviendra. nous allons disparaître, et laisser enfin en paix le reste du vivant, qui s'est fort bien passé de nous pendant des milliards d'années”.
Je vous l’ai bien dit : elle ne mâche pas ses mots !
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.