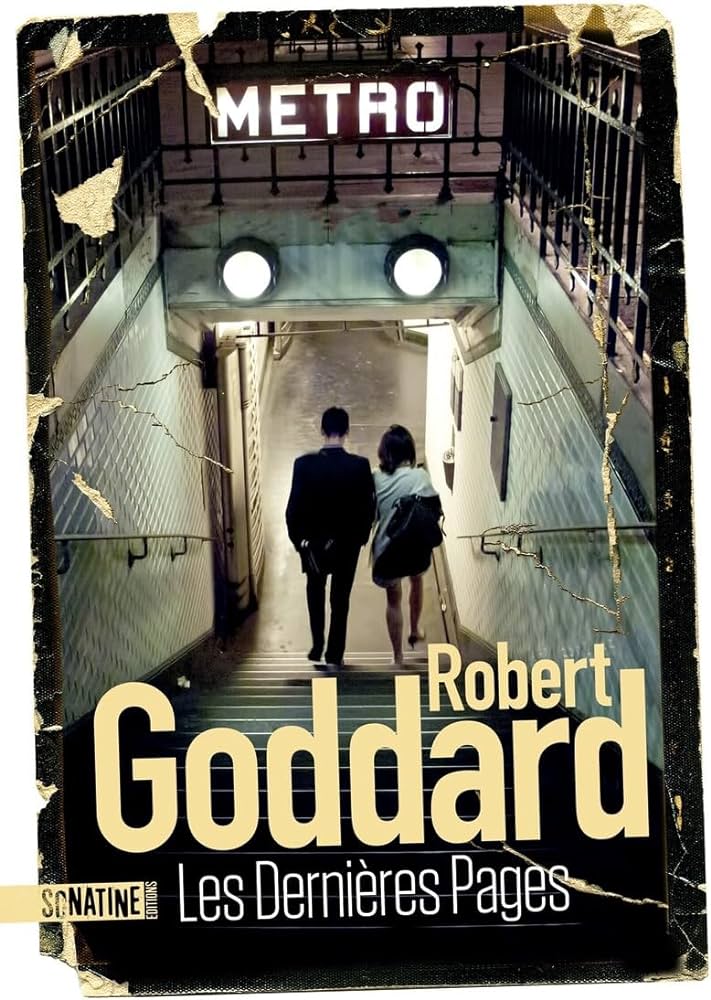

Robert Goddard est un écrivain anglais fort sympathique auteur de romans à suspense et de policiers historiques très documentés.
A son actif, plus de vingt romans depuis 1986 qui tous connaissent un grand succès en Europe et aux Etats-Unis. Nombre d’entre eux ont reçu des prix littéraires prestigieux.
Il est considéré comme le maître du suspense britannique, ses romans sont de véritables page turners qui nous tiennent et nous retiennent dans leurs pages, quels que soient les époques et les lieux où se déroulent les intrigues.
L’histoire de Les dernières pages est extrêmement dense. Si elle peut sembler compliquée au début, les choses s'éclairent une fois la mise en place des faits (la guerre de sept ans qui n’a jamais porté le nom de guerre : “les événements d’Algérie”, “la question algérienne”) et des personnages (algériens, français, anglais) achevée. Je me contenterai de poser les rudiments historiques et de vous présenter les personnages principaux.
L’intrigue commence (dans les pages) à Alger de nos jours, alors que le commissaire Taleb est convoqué par le grand patron des lieux, le directeur Bouras. Il s’agit d’élucider une histoire vieille de quarante ans : retrouver et arrêter deux anciens membres actifs du FLN, Wassim Zarbi et Nadir Laloul, tous deux cachés en France, Laloul depuis l’arrivée de Bouteflika au pouvoir en 1999, Zarbi après vingt ans de prison, dus à son complice, qui semble avoir été protégé par les services de renseignements algériens. Le commissaire Taleb sera aidé par une agente du DSS (les services secrets algériens), Souad Hidouchi. Il s'agit d’une affaire “hautement sensible” pour les deux pays.
S’ensuit la présentation d’autres personnages essentiels lors d’un court passage en Angleterre qui nous met un peu dans un flou artistique c’est vrai ; mais nous en découvrons très vite la justification. Ce passage se déroule de nos jours, il y est question de la covid 19, ce qui nous permet de le situer dans le temps..
Juste après, nous apprenons que l’intrigue a commencé en réalité bien plus tôt. Retour en arrière dans le temps et dans l’espace. Nigel Dalby fait ses études à Cambridge. Ayant appris que sa mère, qui habite Paris, est hospitalisée à la suite d’une chute, il y arrive le 17 octobre 1961. Las, le hasard ne fait pas toujours bien les choses, Nigel Dalby ne pouvait arriver à pire moment.
En effet, dans les rues de Paris, des Algériens défilent, désarmés, sans violence, en scandant “Algérie algérienne”. Parmi eux, des membres du FLN. En quelques instants, à Saint-Michel, Nigel Dalby voit la scène dégénérer en émeute violente. Le préfet Papon a donné à la police de mater la rébellion. Et les policiers ne se font pas prier pour tuer un maximum d’Algériens par des méthodes plus violentes et barbares les unes que les autres. Cette terrible répression a fait un nombre impressionnant (et jamais révélé précisément) de victimes, elle était appelée par les policiers entre eux “un nettoyage en retard” !
Nigel nous dit : “Une date comme une autre, sur le moment. Un mardi ordinaire. J’ignorais que ce jour allait devenir tristement célèbre dans l’histoire. Une histoire que j’allais voir se dérouler sous mes yeux”.
De retour en Angleterre, Nigel rencontre Harriet, diplômée de cinéma à Londres et ils se fiancent. On est en 1965. Harriet ayant décroché un contrat temporaire pour le film Playtime de Jacques Tati, ils partent à Paris. Sur le tournage, ils rencontrent Zarbi et Laloul, les deux Algériens dont il est question plus haut qui veulent venger leurs frères morts le 17 octobre… En remontant au plus haut niveau du gouvernement français de l'époque, le préfet de police et le Général de Gaulle et leurs “conseillers spéciaux”, autrement dit leurs hommes de main... Ils affirment que “le rôle joué par de Gaulle dans les événements du 17 octobre devait être révélé au grand jour”et sollicitent l’aide de Nigel, qui se laisse entraîner. Mais Harriet disparaît du jour au lendemain.
Piégé par Zarbi, Nigel s’installe à Alger, où il ouvre une librairie. Il meurt pendant les années noires, assassiné par des fanatiques musulmans. Non sans avoir écrit son témoignage des faits sous la forme d’un journal-confession. Avec, notamment, une explication de la disparition d'Harriet.
Plus de cinquante ans plus tard, sa fille Suzette (installée en France avec sa mère depuis la période de terreur en Algérie) en reçoit une copie, envoyée par un gros cabinet d’assurances. Elle est censée, moyennant une grosse somme d’argent, attester que ce récit, qui met en cause les plus hautes instances algériennes et françaises, est un faux. Confuse et apeurée, elle se tourne vers le frère d’Harriet, Stephen Gray et se rend chez lui en Angleterre.
La boucle est bouclée avec le deuxième chapitre qui se déroule dans le Hampshire, où vit Stephen Gray. Et avec le tout premier, qui met en scène les deux enquêteurs algériens chargés de démêler les fils multiples et serrés de cet écheveau politico-policier protéiforme : le commissaire Taleb pour la police et l’agente Souad Hidouchi pour les services secrets algériens.
Voilà. En dire plus serait en dire trop. Les décors sont plantés sur une toile tissée de faits historiques réels, les personnages fictifs en route vers leur destin ; l’histoire est en chemin au rythme de l’Histoire. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est difficile d’interrompre la lecture pour une pause quelconque. Jusqu’à la dernière page car le suspense se joue à la minute dans la dernière partie. Et qui sait si la fin n’incite pas le lecteur à espérer une suite aux “aventures” des deux enquêteurs auxquels il s’est forcément attaché… A vous de me le dire…
Pour ce qui concerne l’écriture, elle est tout autant maîtrisée que l’histoire. Le roman est bien écrit et bien traduit. Robert Goddard nous y a habitués, c’est vrai : tous ses romans, en dépit de leur pagination et de leur contenu très dense, sont des “page turners”, mais il faut le souligner au regard de la complexité du contenu lui-même car les lieux, les époques et les personnages virevoltent. Il se passe énormément de choses, le rythme est trépidant et les rebondissements nombreux, mais tout se lit avec une grande facilité car l’ensemble reste fluide, coule de source, y compris les passages historiques et politiques qui pourraient nous ennuyer mais s’avèrent nécessaires (et bienvenues) pour la compréhension générale. Du grand art, vraiment. Une maestria inouïe qui emmêle et démêle absolument tout. Au passage et pour sourire, un auteur qui utilise le mot “nonobstant” dans ses pages ne peut être qu’un excellent auteur. Car ce mot à la sonorité décadente, “nonobstant”, allez savoir pourquoi, est un de mes mots préférés…
Le travail de l’auteur et de ses traducteurs est admirable, tant dans la reconstitution des événements historiques à différentes reprises, que dans la narration romanesque, complexe et dramatique elle aussi. Une maestria assez rare, sans faille de bout en bout, qui fait que nous ne sommes jamais perdus. Si toutefois nous perdons le fil de l'histoire sur quelques lignes, il ne nous en faut pas beaucoup plus pour raccrocher les wagons. Un vrai puzzle dont la dernière pièce est posée sur la dernière page.
Un regard sur le livre. J’avoue avoir bêtement laissé tomber Robert Goddard, écrivain épatant dont j’ai pourtant lu avec grand plaisir plusieurs romans. Manque de temps, trop de livres deux fois par an, trépidance des prix littéraires à laquelle je finis toujours par céder peu ou prou en lisant peu ou prou toutes les premières pages. Et celui-ci m’est tombé dans les mains et y est resté.
Robert Goddard a l’art et la manière de tirer avec brio plusieurs ficelles romanesques en même temps : étude psychologique avec une belle brochette de personnages, histoire du monde (ici celle de la dernière année de la guerre d'Algérie et ses conséquences), ) et un côté suspense avec des rebondissements à la pelle, des personnages poussés à bout, des trahisons, des duperie-mensonges et des secrets de famille à la pelle, des surprises incessantes… le lecteur est pris au piège là aussi, il lui est impossible de lâcher sa lecture.
Les deux personnages principaux nous deviennent sympathiques. Le vieux commissaire algérien d’emblée : blasé, fatigué, aspirant à la retraite, il continue de jongler entre la politique et son métier d’enquêteur, de différencier le mal et le bien quand c’est possible. L’agente Hidouchi, froide et rigoureuse au début de l’histoire, finit par gagner notre sympathie (et celle de son collègue) à mesure que l'histoire avance et que tombent les révélations.
Mais ce que j’ai particulièrement aimé dans ce roman, c’est la relation de l’histoire de l’Algérie. De la nuit du 17 octobre 1961 à la déclaration de son indépendance, de celle-ci à nos jours, elle nous est présentée à mesure – et en même temps que l’intrigue du roman – comme une succession de guerres intestines avec un pouvoir toujours (et de plus en plus) corrompu à tous les échelons de la hiérarchie et une prééminence militaire. Une situation dans laquelle les Français ne sont pas innocents.
Malgré des événements purement liés à l'intrigue romanesque policière, celle-ci s'inscrit profondément dans l'Histoire avec un grand H et dans sa chronologie.
Ce d’une manière très simple, très claire au point que cela nous intéresse tout autant que l’enquête. Une petite leçon d’histoire ou de révision pour les plus anciens, sur un sujet longtemps tabou en France. Nous lisons : “Personne n’apprend jamais rien de l’histoire en Algérie. On se contente de la dupliquer sous des formes de plus en plus dramatiques.”
La journée du 17 octobre à Paris, dûment orchestrée par les “conseillers” du Président français est le point d’orgue de l’histoire. Les faits, qui ont été d’une violence ultime, sont relatés avec moult détails dans le dernier quart du roman ; le passage est difficile à lire.
“La version officielle des événements semblait n’avoir strictement rien à voir avec les scènes auxquelles j’avais assisté. Quelques Nord-Africains tués ou blessés. Plusieurs blessés dans les rangs des forces de l’ordre. Je savais que ça ne pouvait pas être vrai”.
Une petite année plus tard, l'indépendance algérienne est proclamée et les Algériens fêtent l’événement dans les rues. Bon-an mal-an, la vie continue au gré des changements de régime et des Présidents mais pas de “pouvoir”.
Le chaos de la fin des années 80 est un nouveau coup dur pour le pays avec, à nouveau, des morts de civils innocents, comme nous le lisons
“C’est alors que le prix du pétrole amorça une chute propre à saper les ressources financières de l’Etat. L’inflation, la pénurie de denrées alimentaires et le chômage érodèrent le soutien au FLN. Les protestations se multipliaient. Les gens de la rue en avaient assez d’être gouvernés par des anciens de la lutte pour l’indépendance qui ne songeaient qu’à eux. Leur frustration finit par exploser sous la forme de manifestations massives qui commencèrent le 4 octobre 1988. (...) L’armée envahit les rues, tirant sur les manifestants et tuant plusieurs d’entre eux”.
Ensuite, la montée de l’intégrisme religieux allait engendrer les “années terribles”, la terreur de “la décennie noire” des années 90 :
“A partir de là, l’escalade de la violence ne cessa de s’affirmer. Il fallait aussi compter avec le GIA, décidé à islamiser de force l’Algérie. Avec les milices qui avaient des comptes à régler. Avec les gangsters qui voyaient là l’occasion de se tailler de nouveaux territoires. Si on tombait sur un barrage, on n’avait aucune idée de qui le tenait en fait. Tout ce qu’on savait avec certitude, c’est que ces hommes pouvaient vous tuer sans raison valable. La violence finit par acquérir une identité propre”.
“Quand ils ont commencé à se laisser pousser la barbe et à s’habiller comme des Afghans, les jeux étaient faits. C’est alors que les assassinats ont débuté”.
“(...) Les journalistes, les universitaires, les intellectuels, les étrangers et les femmes habillées à l’occidentale devenaient des cibles privilégiées”.
Profitant d’une confusion totale, certains membres haut placés commettaient des assassinats qu’ils mettaient sur le compte des islamistes : “Nous vivions au beau milieu d’une guerre entre deux armées qu’il était si facile de confondre que nous n’avions aucune idée de qui était réellement l’ennemi. Si ce n’est la mort. La mort était la seule constante. (...) Les gens ordinaires ne pensaient qu’à survivre. (...) On ne savait pas toujours qui tuait qui – ni pourquoi. On n’était que trop heureux de simplement réussir à rester en vie jour après jour.”
Robert Goddard va loin, très loin dans ses réflexions, jusqu’à impliquer la France dans les années noires et “les événements qui se reproduisent d’eux-mêmes”, en faisant dire à l’agente des services secrets algériens : “Je pense pour ma part que cet enregistrement apporte la preuve d’une interférence française dans les affaires algériennes sur plusieurs décennies, allant de tentatives de corruption endémiques au sabotage délibéré de notre économie et de notre vie politique. Et c’est ce que penseront tous ceux qui en auront connaissance”.
Et le commissaire Taleb de surenchérir : “Le problème c’est que nous sommes leur conscience. Leur mauvaise conscience. Nous n’arrêtons pas de leur rappeler, même si ce n’est pas délibéré de notre part, les péchés qu’ils ont commis en Algérie. Des péchés, nous en avons aussi à notre actif. Chaque camp a fait surgir ce qu’il y avait de pire dans l’autre. Mais c’étaient eux, les envahisseurs. Ce qui rend leur culpabilité plus grande que la nôtre. C’est ainsi qu’ils nous considèrent – comme un reproche permanent.»
Enfin, l’auteur enfonce le clou quand il nous dit dans une postface courte mais très explicite :
“Cela vaut certainement pour le massacre perpétré par la police parisienne à l’encontre des manifestants algériens la nuit du 17 octobre 1961, et qui reste de loin l’action la plus destructrice de l’histoire moderne menée par un pouvoir en place contre des manifestants dans un pays de l’Europe de l’Ouest. En écrivant ce roman, je me suis efforcé de rendre au mieux l’impact que ces événements effroyables ont eu sur les personnes qui s’y sont trouvées mêlées – et, par voie de conséquence, sur les personnages de cette histoire”.
Oui. Et c’est bien pour ça que Robert Goddard est si apprécié de ses lecteurs. Un auteur à découvrir absolument, ou à suivre pour celles et ceux qui le connaissent. Apprendre l’Histoire (la réviser ?) ailleurs que dans les livres de classe, tout en suivant une intrigue à suspense, c’est un des multiples bonheurs de la lecture.
Et certainement la meilleure manière de comprendre le monde d’aujourd’hui.
DEUX-TROIS MORCEAUX EMBLÉMATIQUES
Quelques vérités générales comme on les adore, ou non :
. “Qu’est-ce qu’une longue mémoire, après tout, sinon un signe de vieillesse ?”.
. “La vie – c’est du moins ce qu’il en est venu à comprendre depuis la perte de sa femme et de sa fille – n’est qu’un terme au contenu tout relatif.”
. “Je l’ai aimé autrefois. C’est plus le cas aujourd’hui. Mais il est difficile de se défaire… du souvenir de l’amour”.
Un clin d’œil nostalgique et amusant :
“Il aurait pu envoyer des textos, mais il préfère la méthode désuète des cartes postales, même si elles mettent parfois longtemps à parvenir à leurs destinataires. Elles sont comme un clin d’œil au passé qu’il a abandonné derrière lui”.
Une “juste” définition du pouvoir à la tête de l’Algérie (et seulement là ?) :
“Une machine aussi infatigable qu’impitoyable, toujours prête à écraser tout groupe, tout citoyen qui oserait rêver d’une Algérie libre et débarrassée de la corruption ; l’ultime arbitre de leurs destinées à tous, qui ne saurait être contesté et, de toute façon, ne peut être vaincu.”
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.