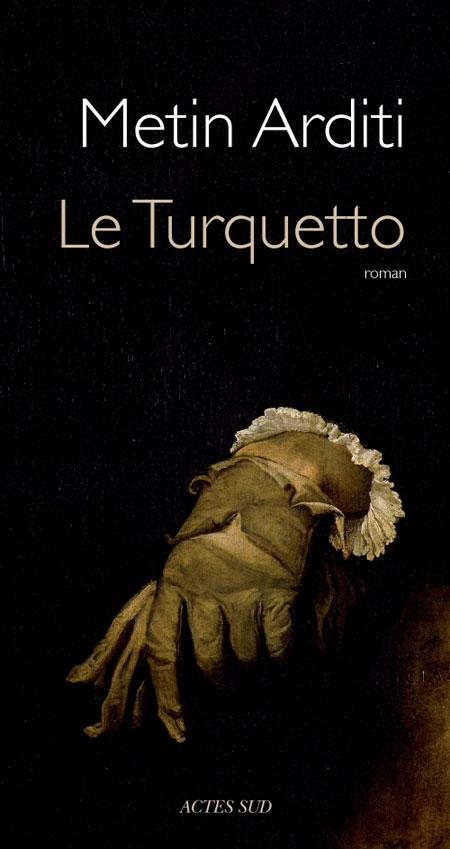Paru en 2011 chez Actes Sud. Rien lu de cet auteur qui a plutôt très bonne presse. Et l’Histoire de l’Art n’est pas ma tasse de thé. Hum ! Voyons voir.
L’histoire. Nous sommes en 1531 à Constantinople. Elie Sorano, dix ans, né de parents juifs, est un petit garçon malheureux. Sa mère est morte après l’avoir mis au monde et son père, malade, est employé chez un vendeur d’esclaves. Elie a honte de lui et de sa condition misérable. Doué pour le dessin et doté d’un sens de l’observation peu commun, il ne rêve que de peindre tout ce qu’il voit. Malheureusement, les religions musulmane et juive interdisent toute représentation de Dieu et de ses créatures. Et son père a honte de lui car il pense que s’il ne respecte pas les traditions religieuses c’est pour trahir les siens.
La première partie, courte, m’a quasiment laissée de marbre : le personnage principal, qui n’est encore qu’un adolescent éperdu du désir de peindre, disparaît brusquement en fin de partie, juste après la mort de son père, alors qu’on commençait à s’attacher à lui et à ses projets.
On le retrouve à Venise 43 années plus tard, en 1574. Pourquoi une telle durée pour séparer les deux premières parties du livre ? Je n’ai pas bien compris, on n’en aura d’ailleurs pas l’explication. Elie est devenu le Turquetto (Le «Petit Turc»), un peintre célèbre et apprécié de tous, surtout du maître Le Titien, dont il a été l’apprenti. Mais l’intolérance religieuse règne à Venise et il ne fait pas bon être juif en pays catholique. Pour pouvoir faire un mariage de raison, il se fait passer pour chrétien. Malheureusement, son secret est sur le point d’être découvert à cause d’une liaison avec une juive. Certain d’être démasqué un jour ou l’autre, il prend les devants (là encore je n’ai pas compris) et avoue sa condition de juif dans un tableau, qui sera son chef-d’oeuvre, La Cène, dans lequel il peint les disciples sous les traits de rabbins et lui-même sous ceux de Judas.
Le reste sera l’affaire de la toute puissante Inquisitation et nous conduira dans la troisième partie, qui verra la décadence de Elie.
Notons au passage que la Venise qui nous est offerte ici est aux antipodes de la Venise des cartes postales. C’est une ville décadente et nauséabonde, aux rues infestées de rats, aux maisons grouillant de puces et de cafards, aux ruelles remplies de mendiants et de malfrats. Et où règnent le fanatisme, l’intolérance et les querelles religieuses.
La description de Constantinople est par contre un peu moins riche.
Je n’en dirai pas davantage sur l’histoire car le suspense est présent dans le roman et pas question de le déflorer.
En ce qui concerne le style, j’ai été surprise au début par des points d’interrogation présents à chaque tournant de phrase ; comme exercice de style on fait mieux. Heureusement, cela se calme en quelques chapitres, à moins qu’on ne s’y soit habitué. Mais à part cette bizarrerie, dans son ensemble le livre est bien écrit.
La construction est inattendue et les quarante-trois ans qui séparent la partie se déroulant à Constantinople de celle se déroulant à Venise reste une énigme, en tout cas pour moi. Parti pris de l’auteur. Soit. Après tout, c’est lui qui commande…
En définitive, j’ai éprouvé des sentiments mitigés pour Le Turquetto. J’ai aimé ce que j’ai appris des techniques de peinture de cette époque, notamment la différence entre la peinture (la couleur, «il colorito» dans tous ses états) et le designo (le dessin, le contour, une représentation beaucoup plus «mentale», spirituelle de la chose vue), technique que pratique Le Turquetto.
J’ai aimé les querelles et les fanatismes religieux ainsi que les luttes pour le pouvoir spirituel où les arts étaient utilisés comme outils de propagande. Et surtout l’amour fou que voue le héros à la peinture, sa véritable maîtresse.
Mais j’ai regretté le manque d’épaisseur des personnages, surtout Le Turquetto, ou plutôt le manque de renseignements que l’auteur nous livre quant aux motivations qui guident ses actions : quand bien même l’action s’accélère dans la partie se déroulant à Venise, le personnage principal n’est pas plus fouillé : aime-t-il la femme laide qu’il a épousée et qu’il a trompée ; pourquoi se dénonce-t-il comme juif par le biais de la peinture et pourquoi ne s’enfuit-il pas comme il l’a fait à la fin de la première partie ? En dehors du regard acéré et compatissant qu’il porte sur ses contemporains, qui lui permet de peindre ses personnages au plus près de ce qu’ils sont et de ce qu’ils ressentent et qui force la sympathie, on ne sait pas grand-chose du Turquetto, alors qu’il est présent dans la plupart des scènes.
J’ai adoré le sentiment d’amitié très fort qui, dans la dernière partie, unira jusqu’à la mort le Turquetto à Seytine, le mendiant cul-de-jatte qu’il avait connu tout au début du livre et qu’il retrouve à la fin. Elie retrouve (ou trouve ?) au contact de cet homme sans jambes une humanité qu’on ne lui connaît pas et sa mort l’amènera à regretter ses erreurs, sa vanité et surtout le mépris pour son père qu’il pourra enfin, dans une scène très courte mais très belle, peindre de mémoire.
Voilà. Je n’ai pas eu de coup de cœur. Peut-être à cause du sujet qui ne me passionne pas. C’est un bon livre que je viens de lire et je sais que mon désintérêt (et ma méconnaissance) de l’histoire de l’Art m’ont empêchée de l’apprécier pleinement à sa juste valeur. Par ailleurs, la seconde partie m’avait laissé entrevoir quelque chose de plus fort que le début. Mais le soufflé est retombé.
Le dernier livre de Metin Arditi, ‘La Confrérie des moines volants’ m’attend sur un rayonnage de ma bibliothèque. Je vais le lire un de ces quat’.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.